Les archives : centrales dans le travail des historiens, elles sont pourtant entourées de beaucoup de clichés, tant dans la manière dont on les étudie que dans ce qu’elles sont réellement. J’ai pu voir comme était parfois ancrée dans l’esprit du public l’idée des « petits papiers » chers à Guillemin, ceux qu’il suffit d’ouvrir pour avoir des réponses. Or, les archives contiennent souvent, en réalité, des questions : tout document s’interroge, se remet en contexte, se réfléchit. Au-delà de ce point de méthode, les conditions de consultation elles-mêmes peuvent être déterminantes, chose que ne manqueront pas d’avoir apprise à leurs dépens les étudiants qui ont la malchance de travailler par temps de crise sanitaire…
Comme pour l’article précédent, c’est donc ici mon expérience personnelle qui va servir de point de départ pour fournir quelques exemples et pistes de réflexions.
Des archives, mais pas n’importe lesquelles !
Pour mon mémoire, que j’ai rédigé en deux années, j’ai eu la chance d’être pris à deux reprises en stage, à chaque fois pour six semaines, au sein de l’association French Lines au Havre. Créée dans les années 1990 pour conserver les archives et le patrimoine des grandes compagnies maritimes françaises, cette association a depuis été divisée en un établissement public de coopération culturelle (French Lines et Compagnies) et une association (Les Amis de French Lines) qui poursuivent ses activités. Ces archives m’ont offert un cadre particulièrement vaste : durant mes douze semaines de stage, j’ai pu consulter plus de 400 cotes concernant le Normandie, pour lesquelles j’avais comme mission de préparer un inventaire détaillé. Une cote d’archive peut en effet correspondre à une petite chemise de quelques feuilles – voire une seule – ou au contraire être un gros carton contenant des centaines de documents, mais, dans tous les cas, sa description dans la base est souvent succincte. Demander une cote, c’est donc souvent ouvrir une pochette surprise, et mon inventaire a permis d’avoir une vision beaucoup plus détaillée de ce que contenaient ces boîtes. Pour ma thèse, je suis également retourné dans les archives French Lines, mais cette fois-ci, hors stage, et donc dans des conditions différentes, sur lesquelles je reviendrai plus bas.
Durant la thèse, j’ai également dû élargir mon champ de recherche au Royaume-Uni, et j’ai donc posé mon dévolu sur plusieurs sites d’archives de Liverpool. Le Maritime Merseyside Museum, tout d’abord, dispose de vastes collections, ayant notamment trait à la construction des navires. J’ai, par exemple, pu y consulter les archives de Leonard Peskett, architecte renommé de la Cunard Line ; ou encore un échange de lettres de Bruce Ismay, président de la White Star, concernant la vitesse du jumeau du Titanic, l’Olympic. J’ai d’ailleurs particulièrement savouré ces pièces puisqu’elles montrent un Ismay refusant que son navire arrive le mardi soir au lieu du mercredi matin, chose qui va totalement à contre-courant de l’image populaire d’un Ismay avide de vitesse et désireux, justement, que le Titanic arrive un mardi soir !

Enfin, j’ai également passé plusieurs jours à mitrailler avec mon appareil photo les archives de l’université de Liverpool, qui contiennent énormément de documents relatifs à la Cunard Line, notamment les rapports de son conseil d’administration. Un problème, cependant : les archives de la White Star sont beaucoup plus rares et dispersées : celles que j’ai pu consulter, datant surtout de la fin de son existence, sont généralement celles que la Cunard avait récupérées pour son usage après la fusion des deux compagnies…
Déjà, ici, une sélection avait été opérée en amont pour choisir les sites où j’avais le plus de chances de rentabiliser mon déplacement ; je regrette, rétrospectivement, de ne pas avoir tenté les National Archives, dont je sais par exemple que mon camarade Mark Chirnside a su les exploiter à merveille pour certains de ses livres sur les navires de la White Star. Une thèse, ce sont aussi ces regrets : on ne peut pas tout faire, que ce soit par manque de temps ou de moyens. Ceci étant, et c’est là aussi un avantage, on n’est jamais totalement seul dans ses recherches, un point sur lequel je reviendrai dans le prochain article. De même, en France, je savais que les archives du monde du travail de Roubaix contenaient a minima certaines cotes relatives à la Transat, mais la description que j’en avais me donnait à penser qu’elles étaient semblables à celles que j’avais déjà consultées au Havre. C’est donc une piste que j’ai laissée de côté, peut-être à tort, peut-être à raison ! C’est là un point crucial : la chasse aux archives nécessite une certaine planification pour ne pas rentrer bredouille et, de fait, on passe souvent à côté d’autres choses qui auraient pu être tout aussi pertinentes. C’est aussi ce qui fait que le regard complémentaire de plusieurs chercheurs sur un même sujet peut être salutaire !
Les conditions matérielles de consultation : un enjeu important
Encore faut-il parler de la manière dont on consulte les archives. En ce sens, mon master et mon doctorat furent des expériences totalement opposées. Lors du master, étant en stage, je faisais en quelque sorte partie de la « maison » : je pouvais aller dans les dépôts chercher mes archives au besoin, et je jouissais d’une grande liberté pour organiser mon travail. Surtout, j’étais sur place pour six semaines, environ sept heures par jour, et j’avais un inventaire à réaliser, ce qui me forçait à consulter, au final, tous les cartons. Si, la première année, j’ai choisi ceux qui étaient les plus intéressants dans leur description, la deuxième, j’ai dû m’attaquer au reste : parfois laborieux et moins intéressant, mais cachant aussi parfois des perles à côté desquelles je serais passé si je n’avais pas eu à faire ce travail.

Pour la thèse, c’était différent : j’étais désormais visiteur. Certes, à French Lines, je restais encore à la maison : celles et ceux qui y travaillaient étaient mes anciens collègues de stage, et je trouvais sur ma table de travail tous les cartons demandés dès mon arrivée. Mais, cette fois-ci, je n’y étais que pour de petits séjours de quelques jours. Et que dire de Liverpool, où je n’ai pu séjourner que deux fois, pour des séjours somme toute assez courts (et les hôtels coûtent vite cher !) !
Dans le cas de Liverpool, justement, les choses étaient différentes et certainement plus proches de l’expérience classique des archives. L’environnement est moins familier, et peut même vite se faire oppressant lorsqu’il faut passer un sas, se débarrasser du plus gros de son matériel, jusqu’à sa sacoche d’ordinateur, puis remplir un formulaire de demande de cote. Je crois avoir atteint ici le summum du ridicule procédurier au Maritime Merseyside Museum, où un formulaire devait être rempli pour chaque cote avec adresse du demandeur et raison de la demande : le fameux échange de lettres de Bruce Ismay que j’ai cité plus haut impliquant une cote par lettre, j’ai dû remplir dix formulaires différents pour chacune des lettres, que l’archiviste consciencieux allait me chercher au dépôt trois par trois, puisque c’était là la limite. Passer plus de temps à demander et attendre les documents qu’à les consulter devient alors pour le moins frustrant, plus encore quand on sait que le temps sera limité (et il l’était d’autant plus que le centre de consultation n’était ouvert que sur des périodes restreintes !).
Dans ce contexte, ceci étant, le doctorant moderne que je suis avait un grand ami : l’appareil photo. Si, lors de mes premières semaines à French Lines, j’ai consciencieusement recopié à l’ordinateur les passages de documents qui m’intéressaient, je me suis vite rendu compte qu’il était bien plus utile de photographier un maximum de documents à la chaîne, en ne les regardant que superficiellement, pour pouvoir m’y plonger plus en détail depuis chez moi. Dès ma deuxième année de master, j’ai généralisé ce système. Les photos étaient prises dans un ordre bien précis, classées dans des dossiers selon les cotes, pour me permettre de savoir en permanence où j’avais trouvé quoi. C’est ainsi qu’à Liverpool, en quelques jours assez intenses (entrecoupés, il est vrai, de pose lecture le temps de charger l’appareil et de me remettre de mes crampes…), j’ai photographié des milliers de pages de rapports du conseil d’administration de la Cunard, que j’ai ensuite pu lire tranquillement de chez moi quelques mois plus tard. Lorsque je suis rentré en France, j’avais peut-être moins de 20 kilos de bagages dans mon sac, mais je transportais bien plus de 20 Go de photos dans mon disque dur…
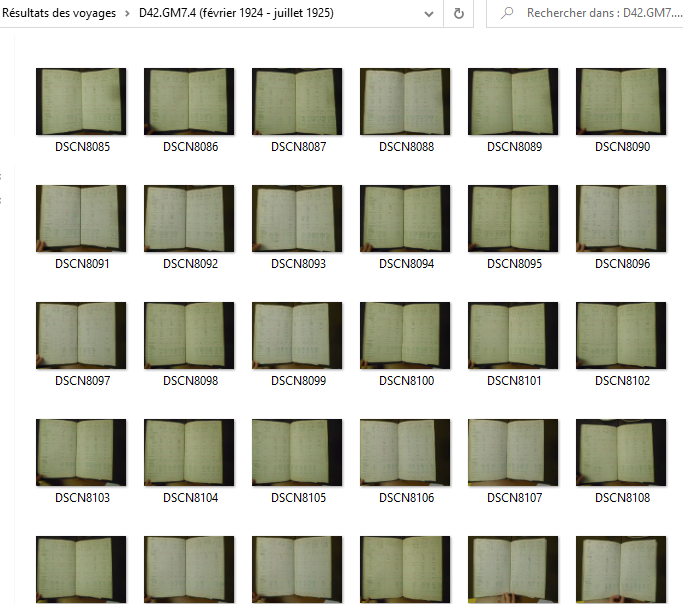
Mine de rien, la photographie numérique révolutionne ainsi profondément les usages, car en quelques jours, il m’était possible de récolter des documents qu’il m’aurait fallu des semaines à retranscrire sur le moment. Autre bonus, des années plus tard, durant la rédaction de la thèse, il m’était possible de replonger dans ma bibliothèque de photos pour vérifier une citation, voire pour poursuivre un peu plus loin mes recherches au besoin. Sans mon appareil, je pense que ma thèse n’aurait donc pas vu le jour !
Ce qu’on cherche…
Une fois évoquées les conditions de recherche, il faut encore s’interroger sur ce que contiennent lesdites archives. Comme je l’ai dit plus haut, lorsque le temps est limité, on se rend généralement sur place avec une idée, au moins vague, de ce que l’on cherche. Si je me suis par exemple attaché à récupérer les rapports du conseil de la Transat et de la Cunard, ou encore les rapports de voyage du Normandie, ou des plans de navires, ou les lettres d’Ismay, c’est que je savais à l’avance que j’y trouverais des choses susceptibles de m’intéresser ; pas forcément tout, mais en partie. Dans le cas des lettres d’Ismay, par exemple, je connaissais déjà leur existence et voulais étudier le détail. Dans le cas des rapports de voyage du Normandie, je savais que je pourrais m’en servir à minima pour étudier les traversées les plus célèbres, et qu’ils regorgeaient d’éléments sur l’exploitation technique et commerciale du navire. Quant aux rapports du CA, ils ne pouvaient que contenir des informations précieuses sur la politique des compagnies !
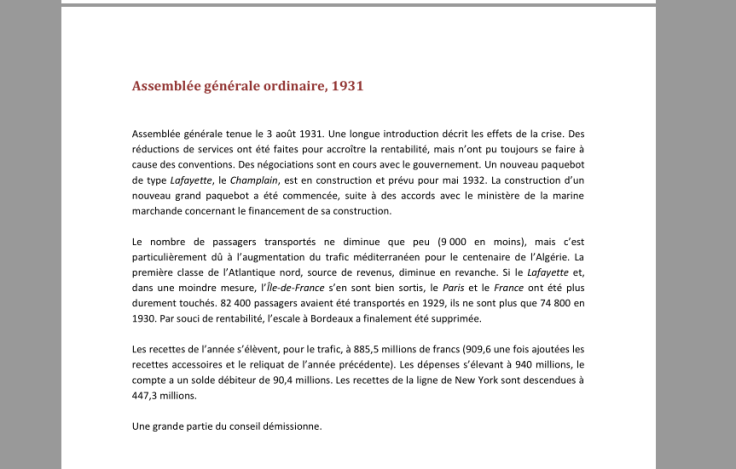
De telles pêches ciblées sont généralement un succès. Je savais par exemple que j’avais besoin des plans des navires pour étudier les conditions de voyage des migrants : c’est une des principales sources sur le sujet, pour connaître par exemple les installations sanitaires, ou comparer les concentrations d’individus. Évidemment, certains plans manquaient, mais tous ceux que j’ai récupérés ont pu servir d’une manière ou d’une autre à cette étude. De même, les rapports du CA de la Transat étaient une aubaine : les soixante années que j’ai étudiées (de 1880 à 1940) reprennent de façon quasi-constante la même présentation, les mêmes sections, et ils sont rédigés de façon limpide (et pour cause : ils sont destinés à rassurer les actionnaires !). Une étude comparative sur la durée était donc fort judicieuse. Mais il y a aussi les déceptions : ainsi, les rapports de la Cunard, pourtant mensuels et beaucoup plus denses que pour la Transat, et pourvus d’index fort pratiques, ont été globalement moins intéressants, les sujets y étant souvent juste mentionnés de façon allusive, sans entrer autant dans le détail. Si j’y ai indubitablement trouvé des choses, j’ai parfois regretté d’avoir consacré tant de temps à une source qui, finalement, n’était pas la plus intéressante que j’aurais pu consulter.
À l’inverse, on peut également savoir à l’avance ce que l’on ne veut pas consulter. Je savais par exemple que la documentation trop technique ne m’intéressait pas en soit, sauf si je pouvais la relier à des thématiques précises. Par exemple, j’ai vite constaté en étudiant le Normandie que la lutte contre les incendies était un sujet central. De telles procédures détaillées ne m’auraient pas initialement intéressé, mais lorsque j’ai découvert dans les archives du Maritime Merseyside Museum un livret sur un sujet proche, même fort technique, j’ai tout de même tenu à l’examiner pour un comparatif.
Reste que certains documents dépassent nos capacités : dans mon cas, je savais que les archives traitant d’architecture navale brute sortaient de mon domaine de compétence. J’en ai parfois mentionné l’existence pour, peut-être, susciter l’intérêt de plus apte que moi à les étudier, mais je n’ai pas pris le temps de les fouiller en détail. De même, certains documents de gestion brute : hypothèques, emprunts et amortissements, assurances, étaient clairement au-delà de mon domaine de compréhension, et, si j’en ai photographié certains au cas où, j’ai généralement fini par me référer avant tout à des notes plus synthétiques, et à laisser ce domaine à plus compétent que moi.
Quoi qu’il en soit, le fait d’avoir un temps et des moyens de recherche limités oblige fatalement à ce genre de sélection. C’est également le lot des enseignants-chercheurs qui, obligés de jongler entre cours, copies, administration, rédaction d’articles et préparation de colloques, n’ont finalement pas un temps énorme à consacrer aux archives. C’est un tort, car cela réduit les chances de voir survenir un autre point important dans la recherche : les découvertes fortuites et surprenantes.
… et ce qui nous trouve
En effet, les archives les plus précieuses, à la fois scientifiquement et sentimentalement, sont souvent celles qui nous surprennent quand et là où on s’y attend le moins ! C’est surtout durant mes stages que j’ai été confronté à ce phénomène, puisque le fait d’être obligé de faire un inventaire complet m’a incité à aller vers des boîtes que je n’aurais autrement pas fouillées. Je prendrai pour commencer un exemple significatif, que je crois avoir déjà évoqué : lors de ma deuxième période de stage, dans ces fameuses archives que j’avais laissées de côté car elles ne m’intéressaient pas initialement, se trouvait une grosse boîte remplie de courriers adressés à la Transat par des décorateurs divers et variés, désireux de travailler sur le chantier du Normandie. La liasse de papier était énorme, plusieurs centaines de courriers certainement, et beaucoup se ressemblaient : il s’agissait souvent de l’éternelle candidature spontanée, parfois accompagnée d’un petit coup de « piston » (« Je suis recommandé par votre ami … », « Nous avons déjà travaillé ensemble pour… »). Cette masse était en soi significative : dans le contexte de la crise des années 1930, un tel chantier était une aubaine que beaucoup voulaient saisir. Et très vite, je trouve quelques lettres qui tranchent avec le reste : certaines juste drôles, comme ce courrier qui indique que le frère de l’auteur n’a pas pu venir à un rendez-vous car on l’enterrait… mais qu’il veut bien récupérer le contrat ! Ou encore ce courrier surprenant du maître verrier André Hunebelle, qui s’emporte contre la compagnie qui ne l’a pas assez sollicité… et est accessoirement le futur réalisateur des Fantômas ! Mais il y a surtout ceux qui permettent une analyse plus fine du contexte, comme lorsque l’artiste peintre Yvonne Sjoestedt proteste face à un refus dû à « sa qualité d’étrangère » qu’elle est née en France, de nationalité française, et ne mérite pas un tel traitement. Et, faisant mon mémoire à l’université de Limoges, je me suis réjoui de pouvoir ajouter une part d’histoire locale à mon travail en découvrant l’intense lobbying auquel se sont livrés – avec succès – les élus creusois en faveur de la tapisserie d’Aubusson.

C’est ainsi qu’une cote au premier abord rébarbative (et qui, dans sa majorité, l’était) devient source d’exemples savoureux et pertinents à exploiter. D’autres fois, le hasard fait bien les choses. Dès le début de mon stage, j’avais entendu parler des déboires de la synagogue du Normandie, par un archiviste. J’ai pu retrouver des détails dans les revues de presse conservées, mais c’est au détour d’un des fameux rapports de voyage que j’ai pu découvrir une tirade du commissaire de bord, se réjouissant du succès du paquebot auprès des israélites, mais craignant également que cela ne nuise à la réputation du navire… Le contexte des années 1930 s’imposait ici violemment à moi et, petit à petit, j’ai réuni de quoi rédiger plusieurs bonnes pages de mon mémoire consacrées à la religion à bord du paquebot (j’en ai d’ailleurs tiré un article, il y a quelques années).
Arrivé en thèse, je faisais face à un gouffre : j’aspirais à comparer la politique religieuse ambitieuse de la Transat à celle de ses rivales britanniques, mais je ne disposais de rien. Je savais, par ma longue étude du Titanic, que la religion y occupait une place assez rudimentaire, mais difficile d’étendre la chose, notamment aux années 1930, qui voyaient les plus gros efforts de la compagnie française. Et puis, dans mes dernières heures à Liverpool, en consultant un peu par hasard des documents sur la construction du Queen Elizabeth (prévu pour 1940), j’ai trouvé un échange de lettres entre un fidèle client canadien et la compagnie : le premier suppliait la Cunard de consacrer ne serait-ce qu’une cabine transformée en chapelle pour le culte anglican ; cette dernière répondait qu’elle n’était pas intéressée. En deux lettres, j’avais une réponse catégorique sur la perception britannique de la question ; une réponse qui m’aurait totalement échappé si j’avais quitté les archives une heure plus tôt, comme mon estomac martyrisé le demandait.
On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein : quelle autre découverte aurais-je pu faire, de fait, si j’étais resté une heure plus tard ? Je pourrais certainement multiplier les occasions de trouvailles fortuites, mais il y a justement un dernier lieu où j’ai pu en faire, sans avoir à me soucier de mon appétit, du reste : Internet.
Les archives en ligne
Internet est formidable pour les chercheurs, au point que certains peuvent même n’avoir jamais à mettre les pieds dans une salle de consultations d’archives. De plus en plus, grâce à cet outil, on peut consulter à l’avance des catalogues d’archives… Mais aussi les archives elles-mêmes, parfois. Je parlais plus haut des plans de mes paquebots français, par exemple : ce n’est pas au Havre que j’ai dû galérer à les déplier ; ils me sont parvenus parfaitement numérisés, par mail, et j’ai pu les analyser en très haute définition, et même les retravailler au besoin. Mais c’est d’un autre usage d’Internet que je veux parler ici : les archives directement disponibles en ligne.
Lors de la rédaction de ma thèse, il m’est arrivé, parfois, de regretter de ne pas avoir l’avis de la presse sur tel ou tel sujet. Gallica a été alors une bible pour rattraper ce que je n’avais pas pu faire avant : j’ai pu consulter le Journal Officiel contenant les débats tournant autour des conventions postales (dont j’ai parlé en vidéo ici), mais aussi d’autres journaux, et même découvrir par hasard une source précieuse, la revue À travers le monde qui, manifestement, se tenait bien au courant de l’actualité en matière de construction de paquebots. Google Livres a aussi parfois été d’une utilité étonnante : en voulant étudier les croisières, j’ai découvert que parfois, des livres commémoratifs avaient été publiés à très petite échelle pour se souvenir de tel ou tel voyage effectué par un groupe. Et ceux-ci étaient parfois numérisés ! De même, grâce à WebArchive et au Projet Gutenberg, j’ai pu lire les mémoires de plusieurs rescapés du Titanic, notamment Lawrence Beesley dont j’ai traduit ici les écrits.
Le Titanic, justement, fait l’objet de belles bases documentaires. Ainsi, le site Encyclopedia Titanica recense énormément d’articles de presse tournant autour du navire et de ses passagers. Je l’ai par exemple longuement fouillé pour tenter de comprendre si oui ou non le milliardaire John Pierpont Morgan avait annulé sa traversée à bord au dernier moment (un point d’ailleurs cher aux complotistes). Plus encore, le Titanic Inquiry Project, qui contient l’intégralité des enquêtes sur le naufrage, est une source extraordinaire que j’ai amplement sollicitée, parfois aussi pour détailler des points relevant de la gestion quotidienne du navire et de la compagnie, ce qui a d’ailleurs beaucoup plu au jury. Mais j’ai aussi pu trouver en ligne des documents sur le naufrage de La Bourgogne, sur l’histoire de la T.S.F., sur les conventions internationales SOLAS… et j’ai même pu aller jusqu’à explorer ici ou là la presse néo-zélandaise de l’époque !

Sans ces archives en ligne, ma thèse n’aurait clairement pas eu la même qualité, mais il faut malgré tout aborder leur aspect le plus négatif : leur volatilité. Ainsi, lors de la rédaction de ma thèse, début 2016, j’ai beaucoup utilisé le site des archives Gjenvick-Gjonvick, qui est avant tout destiné aux généalogistes et collectionneurs : on y retrouve des retranscriptions de brochures, d’articles de presse et ainsi de suite, en particulier relatifs à l’immigration transatlantique, mais le site a également une vocation commerciale : vendre les documents originaux et des reproductions, par exemple. Ce site a été une bible pour moi, dans le sens où j’y ai trouvé maints articles de presse d’époque, forts utiles et intéressants pour mon chapitre sur les migrations transatlantiques. Et pourtant… quelques années plus tard, lorsque j’ai voulu préparer la publication de ma thèse, une partie des liens étaient déjà morts, certains articles avaient été déplacés, ou retirés… J’avais heureusement tout enregistré dans mon ordinateur par précaution, mais il n’en reste pas moins que cette problématique de la pérennité du web est de plus en plus cruciale pour les archivistes et historiens d’aujourd’hui. Je ne peux que recommander, à ce sujet, le passionnant chapitre consacré aux sources sur Internet dans l’Initiation aux études historiques dont j’ai déjà parlé…
Le goût – et l’odeur – de l’archive
Avec cet article, j’ai donc voulu vous parler de mon vécu aux archives, et de ses aspects bêtement pratiques. Je ne me suis pas attardé sur la manière dont on les analyse, dont on les fait parler, car c’est un thème récurrent dans mes vidéos et articles de vulgarisation. J’ai aussi laissé de côté un aspect pourtant important : les sensations propres à la consultation d’archives.
Même si je ne pense pas avoir l’âme d’un chercheur (je suis bien plus satisfait lorsque je rends accessible la recherche existante !) mes premiers contacts avec les archives sont des souvenirs qui gardent une place à part dans ma mémoire. Ouvrir certaines boîtes d’archives, c’est découvrir un monde à part. Les documents sont évidemment très divers : photos, plans, courriers soigneusement dactylographiés, ou au contraire écrits au crayon à papier désormais à peine lisible ; dossiers soigneusement constitués, ou au contraire joyeux bordel mal rangé il y a des décennies… Chaque cote, certaines vues et revues, d’autres au contraire jamais consultées, cache ses petites surprises.
Il y a un véritable aspect sensoriel dans la consultation des archives, qui chez moi a pris des dimensions particulières. Que ce soit l’odeur du vieux papier un peu poussiéreux qui finit par transformer mon nez en fontaine à l’issue de mes séances de consultation, ou la texture parfois très irritante au toucher de certains documents, les archives ne sont pas toujours un cadeau, et pourtant, elles apportent aussi parfois une véritable satisfaction visuelle, et une expérience plus large : ce sont parfois des enveloppes à ouvrir, des journaux à feuilleter, un peu comme dans les livres pour enfants les plus ingénieux. Quelques années et un diagnostic d’autisme plus tard, je vois aussi cette période dans les archives avec une autre grille de lecture, car il n’y a pas à douter que mon hypersensibilité sensorielle a joué un grand rôle, tant positif que négatif (mais surtout positif, je pense) dans ma perception de cette expérience.
En définitive, le temps dans les archives est souvent le plus dense de tout un cycle de recherche. Le travail de réflexion, de bibliographie, et même de rédaction, est souvent propice à la procrastination et à l’éparpillement. En archives, le temps est beaucoup plus compté, en particulier lorsqu’elles sont loin : le temps, c’est véritablement de l’argent, lorsque passer un jour de plus aux archives implique de payer une nuit d’hôtel ou de reprendre des billets de train, voire d’avion ! Le timing doit donc être bien calibré, et quelques jours dans les archives peuvent vite être physiquement assez fatigants (plus encore quand on se casse le dos à trouver la position la moins inconfortable pour photographier vite et bien beaucoup de documents).
Mais une fois les archives bien dépouillées, suit maintenant le dernier gros morceau, qui fera l’objet du prochain article : la rédaction, période de tous les doutes… et des rêves bizarres.

Toujours remarquable
J’aimeJ’aime
Je partage pleinement ce rapport du chercheur en archives qui a été bien expliqué, avec la belle image de la « boîte à surprises » et me retrouve tellement avec ce « travail de …rédaction, (est) souvent propice à la procrastination et à l’éparpillement ».
La fréquentation des dépôts d’archives est en berne :)( on s’autorise à tout le mieux quelques carottages et sondages, en se privant de réelles immersions archivistiques !
J’aimeJ’aime
Un super article… on s y croirait !
Je partage ton avis sur l utilisation « à la chaîne » du numérique pour photographier les archives quitte à hélas ne pas profiter de leur découverte « sur le moment »
Mais quand on attend parfois des années pour mettre les pieds dans ce monde (vive la province et les contraintes familiales) ça vaut le coup.
Il me tarde de monter à nouveau à Paris profiter de certaines…
J’aimeJ’aime